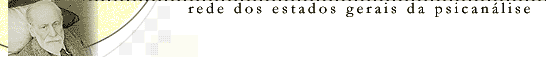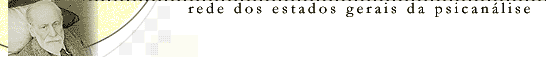| |
<<
BACK
Em Memória
de Jacques Derrida

Hommage
de René Major à Jacques Derrida
publiée sur Le
Monde
Je savais bien
que selon la loi de l’amitié,
comme il s’est employé lui-même à le
démontrer, l’un doit toujours
mourir avant l’autre. Mais je m’étais
toujours refusé à penser qu’il
serait le premier. Je le lui avais même
dit un jour. Il s’en était étonné.
En effet, pourquoi lui refuser cela ? N’était-il
pas toujours le premier à s’aventurer
sur les questions les plus difficiles, à les
donner à penser pour longtemps encore
? Qui aura, mieux que lui à ce jour,
pensé la mort de l’autre, l’aura
pensée sans calcul, sans culpabilité,
sans pardon, sans expiation, sans dette ? A
l’écart de tout ce qui nous est
si familier.
Comment ne pas trembler au moment de prononcer
ici même son nom, Jacques Derrida, pourtant
si souvent prononcé, comme il trembla
lui-même à la mort de son ami Maurice
Blanchot, à l’instant de prononcer
son nom ? Parler, se taire, l’un et l’autre
aussi impossibles, comme il le disait à la
mort d’un autre ami, Paul de Man. Les forces
et la voix nous manquent, comme elles lui manquaient
ces derniers jours. Elles manquent à tous
ceux qui ont la chance de le connaître,
de partager son amitié, et pour qui son
absence restera à jamais impensable. Une
amitié chaque fois unique, comme est unique
la fin du monde [1] que son interruption entraîne
avec elle.
Ce fut une amitié de quarante ans sans
ombre. Je ne saurais dire pourquoi elle fut sans
ombre. Ce que je sais c’est qu’aucun
alibi ne venait l’entraver. Combien de
fois l’ai-je entraîné ailleurs, à Lille, à Toulouse, à Montpellier, à Londres, à Madrid, à Rio
de Janeiro, sans qu’il s’y dérobe.
Chaque fois, il ouvrait à la pensée
des voies nouvelles, autant à son aise
en psychanalyse qu’en philosophie ou en
littérature. Il me fit participer, sans
que ce fut jamais selon un quelconque contrat
d’échange, à tant de colloques
en tant de lieux et de pays. Nous étions
ensemble, nous nous gardions ensemble, sans être
dans un ensemble nommable. Un jour nous nous
interrogions sur ce qui nous faisait être
ensemble. Il me répondit : « Ce
sont nos dissidences, nos genres inclassables ».
Dorénavant, nous serons ensemble séparés
dans la nuit. Je suis sûr que d’autres
le seront aussi comme moi.
On dit aujourd’hui qu’il est « le
dernier grand penseur ». Et cela est vrai.
C’est donc la fin d’un monde. Tout
un monde ! Un monde où l’on pouvait
compter sur lui pour jeter une lumière
sur tant de questions qui laissent l’avenir
si incertain, si improbable. Qu’elles soient
politiques, juridiques, sociales et inconscientes,
qu’elles concernent la guerre, la démocratie,
le pardon, l’hospitalité, la justice,
l’immunité et l’auto-immunité,
le rapport à l’autre comme tout
autre. Tout ce qu’il faudra désormais
penser avec lui sans lui.
Je n’ai jamais connu un penseur d’une
telle puissance qui ait autant d’égard
pour l’autre. Aux colloques où se
faisaient des exposés autour de son œuvre,
il pouvait répondre longuement à ses
interlocuteurs en faisant preuve de la plus minutieuse écoute.
Il était aussi attentif et généreux
dans ses amitiés.
S’interrogeant sans relâche sur
tout avec une acuité incomparable, il
le faisait aussi sur lui-même. Convié en
l’an 2000 aux Etats Généraux
de la psychanalyse, il avait axé son propos
sur la cruauté et sur un impossible possible
au-delà d’une souveraine cruauté en
se demandant si le seul discours qui, sans alibi
théologique ou autre, puisse revendiquer
la chose de la cruauté psychique comme
son affaire propre, n’est pas celui de
la psychanalyse, le seul où le mal radical
ne serait pas abandonné à la religion
ou à la métaphysique et pourrait
rendre compte d’une jouissance à faire
ou à laisser souffrir, à se faire
ou à se laisser souffrir, soi-même,
l’autre comme autre, l’autre et les
autres en soi. Les temps qui sont les nôtres
ne manquent pas d’exemples les plus insoutenables.
Récemment, alors qu’il était
atteint d’un mal qui le faisait souffrir
quotidiennement, il se demandait si tout ce qu’il
avait dit ce jour-là n’était
pas aussi dans l’anticipation de ce qui
lui arrivait. Je trouve aujourd’hui dans
le post-scriptum ajouté à sa conférence
: « Et s’il y avait du « ça
souffre cruellement en moi, en un moi » sans
qu’on puisse jamais soupçonner quiconque
d’exercer une cruauté ? de la vouloir
? Il y aurait alors de la cruauté sans
que personne ne soit cruel. […] Et si
un pardon peut être demandé pour
le mal infligé, pour l’offense dont
l’autre peut être la victime, ne
puis-je aussi avoir à me faire pardonner
le mal dont je souffre ? »
Je crains que le mal dont nous allons souffrir,
nous, ne soit impardonnable.
René Major
Le 9 octobre 2004
[1] Jacques Derrida, Chaque
fois unique, la fin du monde, éditions
Galilée,
2003. En anglais:
The work of Mourning, The University of Chicago, Paris, 2001
|
Texto na íntregra para download
no formato Acrobat (.PDF)
Texto completo para download
en el formato Acrobat (.PDF)
Texte en entier pour download
dans le format Acrobat (.PDF)
Text in full for download
in Acrobat format (.PDF)
|
| PORTUGUÊS |
FRANÇAIS |
|

Si vous ne
possédez pas le logiciel Adobe Acrobat,
cliquez sur l'icône ci-dessus (téléchargement
gratuit)
|
|
|